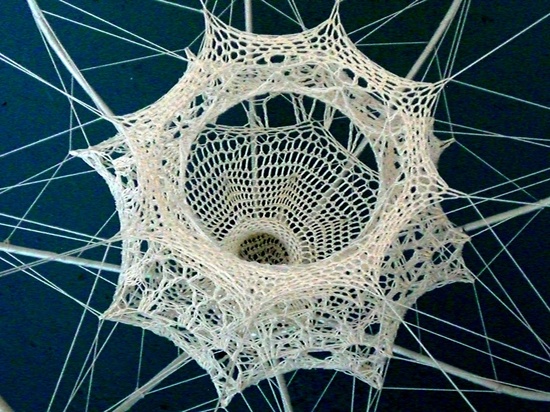Ce diaporama nécessite JavaScript.
Je croyais qu’entre toi et moi
il ne restait pas qu’un espace vide,
que tu voyais que ma main
effleurait tes silences
t’attendait en retrait avec la patience
limpide et solide du cristal.
Les plumes légères de tes ailes
sont devenues des griffes,
elles ne protègent plus
tes sentiments fantomatiques
tu n’as plus de visage,
voilà que je l’efface facilement.
Sont nés de ton labyrinthe de non-dits
des vieilles rancunes,
des espoirs déchus.
Tu n’aimais plus que gouverner
mes heures.
Voyais-tu encore seulement que j’existais
à la manière des anges et que mes plumes
servaient à me décrire en transparence ?
À quelles paroles as-tu prêtées plus d’importance ?
La forme la plus simple d’aimer
est la sincérité.
Alors, je me suis envolée à tout jamais
sans éprouver le moindre regret de m’être gaspillée rien
que pour toi et cette île au trésor qui n’existe pas.
Je croyais vraiment que tu te consacrais à la construire.
Je ne suis plus une colère,
le fantôme qui tremble
de ne pas correspondre aux moules
dans lesquels je ne faisais que fondre
en larmes
comme les déchets d’échecs en échecs
de dépressions en dépressions.
Aujourd’hui
je monte et te démonte.
Je suis désormais si loin de toi
que je ne reviendrai pas.
Il n’y a plus de haies
nerveuses du piaillement
de moineaux qui se disputent
un morceau de faux printemps
ni de passants perdus
qui pourraient me parler
de celui que tu es
vraiment devenu
à côté de quelques cendres
et de ce magma noir qui a
tellement vieilli qu’il est devenu
dur.
T’es-tu seulement aperçu de ce que tu as perdu ?