
Le dernier né
De la tourterelle lance
Un appel depuis le pin
L’arbre sous les reflets duquel
Je lis laisse tomber une feuille
En forme de larme
Sur mon sein gauche
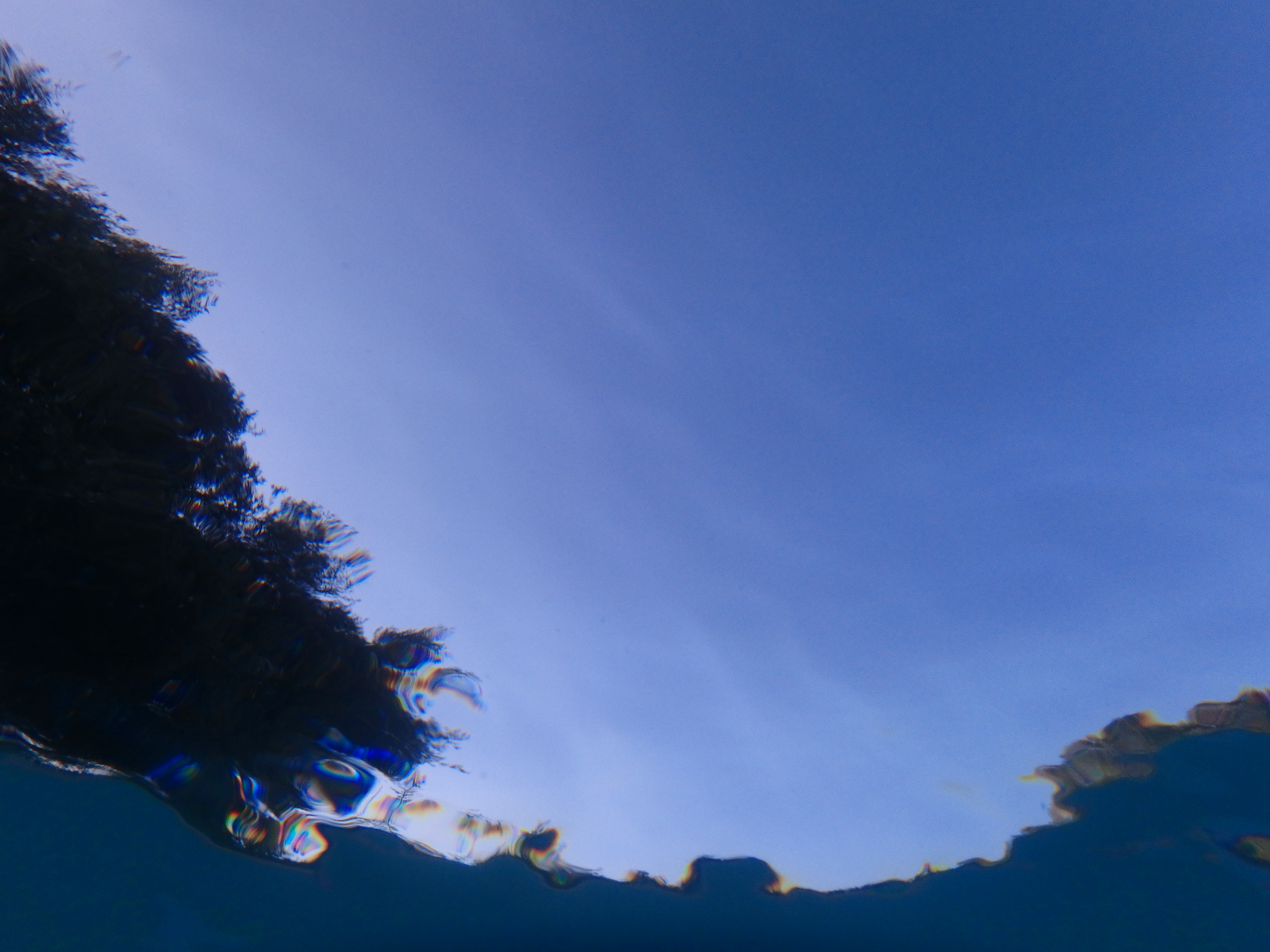
Sous l’olivier je lis
et par dessus mon épaule les ombres agitées de l’arbre semblent courir au delà des phrases,
elles balayent les mots.
L’ombre de l’arbre et moi ne lisons pas le même livre, me dis-je.
Pourtant, je l’entends chuchoter en caressant les signes de la pointe de ses feuilles, elle lit comme si elle était aveugle, du bout des doigts, se sert de la sensibilité tactile des mots, chaque syllabe est un objet, un personnage, un tronçon remarquable du bas-relief qu’elle éclaire à la lumière de son regard.
Il est des signes qui sautent aux yeux et d’autres qui fuient.
Je souligne.
L’ombre suggère de raturer, de hachurer, voire d’arracher la page.
Elle n’a pas tort cette ombre de l’arbre. L’analyse qui propose comme noeuds d’attaches une psychose, une crise oedipienne, une hystérie de symptômes et de phases toutes sorties de la tête de F à de simples oeuvres poétiques, à une aventure telle que le poème ne mérite pas d’être lue par l’être silencieux, l’ombre de l’arbre associée involontairement à ma position.
Mais l’arbre a fini de lire. Il cherche à faire de ma chevelure un feuillage, sa frondaison qui éclabousse la lumière. Mes cheveux sont comme les crinières des prairies, comme les toiles décousues des épeires qu’il malaxe pour qu’elle devienne épaisse ma chevelure comme un nuage.
Les plus longues mèches tendent de s’accrocher aux lèvres, de rester sur mes joues et d’autres de se faire prendre au piège par les cils.
Ainsi adossée au tronc lisant je deviendrais peut-être une partie de lui-même.
Mais lorsque je regarde les mélanges de couleurs, de feuilles, de fleurs à naître je me demande
si je serai à la mesure de leur souplesse
si comme toujours ma démarche saccadée de pied équin
ne passera pas au premier plan
avant que je n’ai eu le temps de me montrer sous mon aspect de végétal
qui ressemble plus aux parfums
qu’il diffuse à la lumière
qu’il absorbe et dévore pour nourrir son ombre.

Les ombres du pin se sont mises à trembler comme les flammes d’un incendie. Je me suis sentie vaciller, partir en titubant et frôler ce qui venait de s’allumer. J’ai songé à la prochaine étape qui enchaînerait à elle toutes les autres comme dans un dédale aux dimensions exactes. J’étais le cheval, une pièce d’un jeu d’échec où finalement on gagne un peu plus de temps et d’espace, de répit avant le prochain combat.
Le tronc impassible de l’arbre ne répondait pas mais l’air coulait de ses bras comme les larmes à l’origine des sueurs froides et des peurs en cascades.
Impassible le géant, pourtant il se jouait quelque chose à la pointe de chacune de ses aiguilles plantées dans la nue comme l’épée de Damocles.

Par dessus mon épaule pousse
la main caressante d’un arbre ancien
la douceur de son ombre -phalanges fines des doigts-
se pose sur le poème que la page d’un livre
me donne en toute pudeur
la main de l’arbre tremble
comme le reflet d’une eau
il lit entre les mots nourri d’un savoir
que les hommes ne possèdent pas
je sens que le soleil frémit en même temps
que son âme il éprouve je suppose une extase
à la pensée qu’il est un arbre
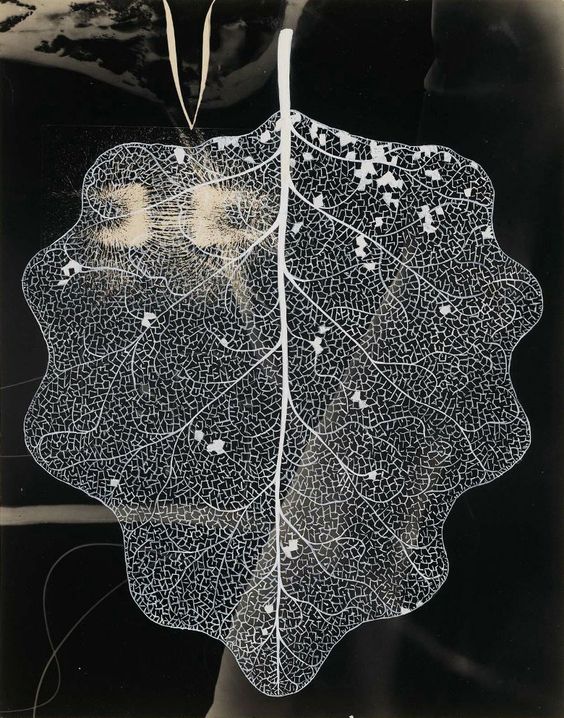
Suis-je un oiseau
non une feuille sèche posée aux pieds de l’arbre entre les racines qui débordent de la terre
quelques notes me font respirer me soulèvent et puis me laissent fabriquer un tapis de poussières
je rêve là parmi mes soeurs de l’été mes amies de l’hiver à de longues phrases ouvertes
l’arbre dans son sommeil murmure
qu’il a découvert le lit souterrain d’une rivière
crépitent les pas des petits mammifères
rien n’est plus doux que la mélodie de leur minois
parfois roule un fruit parfois une écorce devient phalène
parfois plus rien ne m’empêche de laisser aller mes larmes
le soleil le vent l’hiver le temps la nuit
feront ployer les épaisseurs grises agglutinées au delà des branches de l’arbre que je portais dans mes veines
l’été
une chanson une dentelle qu’on jouera du bout des doigts
jusqu’à ton âme
devrait subsister

Du ciel
la lueur
pleure
un lac
blanc

à sa surface
les feuilles
sont
les paupières
de l’arbre
il se regarde
fondre et trembler
dans l’eau
il se garde
du ciel
la lueur

un lac blanc
pleure
les feuilles
de l’arbre
à la surface
du ciel
sont
les paupières
Est-ce la voix du spectre qui se reflète à côté de la mienne ou est-ce
simplement la forêt
qui tremble lentement sous les larmes
qui se noient dans l’encre
qu’absorbe le papier
comme une membrane transparente
on promet longues vies aux mensonges
Est-ce la voile de ce souvenir
qui chante
qui décline toutes les nuances
bleues et vertes
calfeutrées dans les bourgeons du songe
Est-ce le temps qui me mange et ronge
l’espace qu’il m’avait alloué le jour
de ma naissance
Est-ce moi dénudée
de sens
en train de devenir un mirage
photos Bertrand Vanden Elsacker

Autour de sa maison, l’herbe ressemble à de la mousse verte dont les ondes douces se laissent vaguement toucher par la lumière comme un ruisseau turbulent. Des buissons d’une couleur profonde offrent une protection contre les vents ou la pluie. Leurs branches fines comme des fils servent de partition à une colonie d’oiseaux et d’oisillons en tout genre. Certains vous diront : « quelle cacophonie ! Laissez donc la ville l’effacer avec ses bus, ses grues, des coups de klaxons, ses nuées de passants pressés ».
Dans ce jardin, petit comme une main, un arbre berce ses plumes dans le ciel depuis qu’il existe des printemps. Quel endroit somptueux pour habiter ! On y sent battre le cœur tout proche de la veille ville qui ne cache pas son or et nous dit qu’elle est une reine.
L’habitation pourtant est provisoire et ce ne sont que deux ou trois pavés trouvés aux hasards des errances qui retiennent les quelques coins d’une tente fatiguée, usée, décharnée et dont il ne reste plus qu’un seul os rongé. Une bâche bleue en assure encore peut-être pour quelques heures la fébrile étanchéité.
Dans quelques minutes, deux chiens policiers réveilleront l’être humain qui dort là, comme un de leurs vieux jouets. Mais dort-il vraiment ? Ou est-il simplement ivre et malade d’être devenu un déchet de notre société? Quoi qu’il en soit, il a pu à lui seul, sans aucun cri ni fière affirmation marquer un temps d’arrêt en cet endroit où des merveilles sommeillaient à côté de lui sous la pluie, dans le froid. Les verts tendres, la lumière adolescente se jouant de la pluie, la sonorité d’un arbre dont le tronc brun et fort nous fait oublier comme les secondes sont fragiles et si peu dociles.
Ces choses disposées là comme si elles avaient à former un véritable jardin, un tableau, appartiennent à tous ou n’appartiennent plus à personne. La Beauté est vagabonde et nous questionne. Comment nous faut-il l’aborder ?
J’oscille dans l’air
comme les brindilles
d’un incendie
ma voix suit celle de ces mystères
qui tremblent face au soleil dans les déserts
pourtant en moi coulera toujours
au delà des déclinaisons et des détours
une onde resplendissante de fraîcheur
qui te fera croire que ma parole naît vit et meurt
dans les ruisseaux qu’encadre la verdure
qu’enlace le soleil en laissant ses cigales
chanter et danser à sa place
j’ondule comme le serpent sur la dune
langue de vipère petit morceau de terre oublié
par les ravages des rivières
caillou jeté pour rien dans l’eau
le silence me froisse et me désespère
j’avance je me mélange à la sève dans les veines
de la feuille à la pointe de l’épine
Je brûle de me répandre de piétiner l’éternité
de mentir à la vérité
je me pends au cou du premier arbre
si tu tentes par tes phrases d’enterrer ma liberté

——Andreas Nicolas Fischer
•
À l’intérieur d’un arbre
tu vis
l’état endormi de la feuille
à fleur de tout
qui attendait de pouvoir
ouvrir ses pétales de brume
folie latente de la vie
existe-t-il l’instant où l’eau
ne se trouble plus