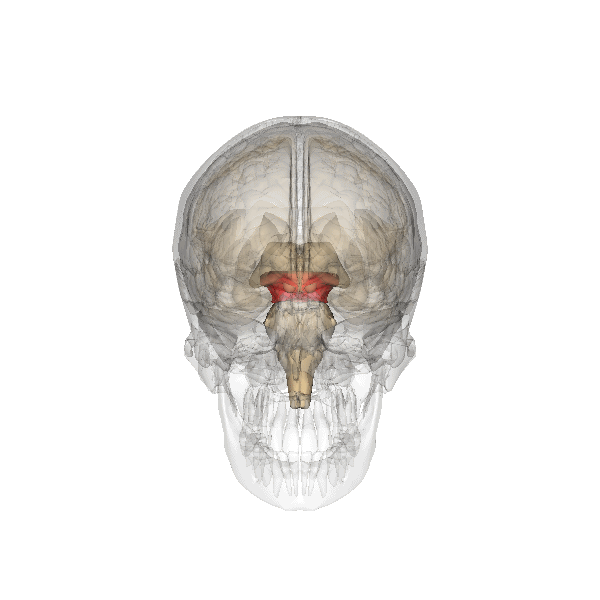Les gens n’ont pas de visage, ils portent des masques, depuis que tu n’es plus là. Leurs corps est un costume. Ils n’ont presque pas de caresse et ne veulent pas d’histoires. Ils enfoncent leurs phrases dans ma tête comme on plante des flèches dans le corps de la bête que l’on veut abattre. Leurs traits déteignent et puis s’éteignent.
Comment pourrais-je encore faire partie de la fête puisque tu n’es plus là ? Je ne peux même pas parvenir à me faire une idée pour les adorer ou les haïr. Ils me rendent vide, il me laisse sec et froid. Les plis du sourcil, la cerne sous l’oeil, la bouche sont engloutis. Le regard lui-même est dissolu. Ils n’ont plus l’âme humaine mais celle du rat prisonnier qui se rebiffe et se sait perdu.
Les gens ne tiennent pas leur parole, ils disent n’importe quoi. Il n’en est pas un seul qui se tienne droit. Ils ressemblent à ces morceaux de chairs sur les étales des bouchers, à des spectres grimaçants, à des lambeaux de vies. Les gens se pendent désespérément au cou du néant.
Plus personne ne peut penser qu’ils puissent encore mener une vie juste et sincère. Ils ne l’ont jamais interrogée. Leur existence est factice et patauge dans les marais ou les chemins de boue. Les gens se nourrissent de mensonges ou s’en contentent, depuis que tu n’es plus là.
Depuis que tu n’es plus là, jamais plus je n’avance. Je rampe ou je tremble à tâtons.
La dégénérescence siège et recouvre tout l’espace, s’accapare la plus grande ombre. Le dernier soupir, la dernière évocation de la vie surgit dans le geste de ma main qui refuse maladroite, cet état. Car dans le fond, je ne me sens plus être, je ne trouve plus les mots, depuis que tu n’es plus là. Je ne suis pas si différent de ces troupeaux de bœufs, de vieillards pontificaux, rances ou rongés par l’oubli. Je me sens qui sombre et me défait. Happé par le cahot, j’accepte la défaite, je me rends immonde, depuis que tu m’as quitté.
La lumière est exsangue, elle est suicidaire et a envie de se pendre. Elle traîne et s’arrache les vêtements en criant sa folie. Voilà ce qu’est devenue ma révolte, depuis que tu n’es plus là.
L’anéantissement brutal de la certitude, la menace, la perte ou l’excès de raison pèse sur ma conscience, brise mes épaules et ploie ma colonne.
Je pensais que je ne t’oublierais pas. Je pensais toujours pouvoir reconnaître le goût de ta peau, la chaleur de ton corps. Je pensais que je n’oublierais pas le velours de ta voix, la fraîcheur de ta main et ton odeur lorsque tu me revenais de l’hiver, de la nuit, de la pluie. Je pensais que tu ne porterais jamais de masque, comme le monde et comme eux, mais je constate non sans horreur que je t’en ai fait porté un.
Low