
Le temps m’est conté
mais qui m’oblige
à l’écouter
χ
il porte un masque
un loup
me regarde
χ
une meute de mots
montre ses crocs

Le temps m’est conté
mais qui m’oblige
à l’écouter
χ
il porte un masque
un loup
me regarde
χ
une meute de mots
montre ses crocs

Cela a toujours voyagé en moi. Souple, pourvue de tentacules et de plusieurs âmes, symptomatique, elle se cramponne des jours aux structures fortes de mon être. Sans rien laisser paraître, elle me fait disparaître.
Agglutinements de jours et de nuits où la douleur prend lentement la forme de mes cartilages. Cela me ronge. Cela me coagule. Cela n’est même pas ma maladie.
C’est une incarnation volatile. Céphalopode invisible avec cet organe corné en forme de plume. Il écrit en se mouvant en silence dans un espace infiniment intime. Cela s’exprime avec une limpidité florale.
Son cri me tétanise et se laisse dissoudre dans les larmes. Son manteau parfois se pose sur mon propre encéphale fantôme. D’une circonvolution à une autre, cela murmure, rugit, appelle. Quel monstre !
Entre cela et moi pourtant, une alliance a fait naître des forces, une résistance aveugle au monde des autres. La bulle d’air de cette autre planète faite mienne, enveloppe chacune de mes sorties.

Je rêve d’un paysage qui au delà de la ligne plus foncée de l’horizon ne se reproduirait pas ridiculement identique à lui-même. Je rêve du bleu qui ne rutile pas comme les armures d’acier que fabriquent à la chaîne toutes les sociétés. Je rêve du bleu qui bien loin d’être froid, mange à grande bouchées le soleil qui se laisse un peu aller à la fin de l’été. Je rêve d’un pays né pour être contemplé, d’un pays qu’on ne peut piller.
Je rêve à la couleur de ta peau laiteuse, abreuvée par les mêmes effluves que les pétales de roses. L’onctuosité crémeuse de la chair qui se pose au milieu de l’existence et pour laquelle dans le noir, le vert, le rouge échangent sans commettre de guerres les étoffes fabuleuses de leurs manteau. Je rêve de ton front qui transpose les solitudes les plus tenaces, les moins inutiles en prose que ma langue vorace et mon oreille amoureuse entendent se battre, s’écouler, se résoudre dans ce souffle qui caresse les vagues.
Je rêve d’un tableau où je n’aurais plus à me proposer comme une tache que malgré tant d’efforts rien n’efface, je rêve d’être dans l’ombre sinueuse d’un mouvement de l’âme, je rêve d’être happée par le vol illuminé d’une méduse dont la limpidité est née là où rien ne naît. Une nuit qui ne connaît que sa propre profondeur sans limites précises. Je rêve d’être le pistil sans poison, le fil presque liquide d’une vie sans horizons. Je rêve d’un tableau où le fond serait semblable à celui de la mer. Vu du bord, il ne porte que l’infini. Vu de lui-même, il constelle comme un rêve qui ne peut aboutir.
Je rêve d’un voyage étroit comme une seconde qui galope affolé autour d’un petit grain de sable. Je rêve du bruit de l’incommodité, de l’essoufflement du gouffre, de l’impossibilité qu’ont les mots et leurs semblables, signes, ponctuations à s’arrimer à ces histoires, ce gaspillage, la salive ou la bave d’un homme qui se croit plus malin. Je rêve de jours qui n’avancent à rien, sont dépourvus du moindre espoir et n’ont que de la grâce. Je rêve d’un milieu qui ne manigance rien avec l’absolu. Je rêve du bleu presque blanc, presque noir. Je rêve qu’en fermant les yeux je me retrouve dans un face à face silencieux où je n’ai plus rien à craindre si je viens à perdre le sens de la réalité.
Dans la baie de mon bras, la nuit est un chat. Pas encore noire, elle luit, bleuit, éclate, effleure, ronronne. La fourrure féline montre les formes sombres des rayures ou les déclinaisons magiques de taches presque rondes comme les astres. La nuit a des griffes rétractiles et une langue rose. Quand elle marche, elle ne fait pas le moindre bruit et parfois elle ose montrer l’endroit de son ventre où elle est blanche. La nuit apprivoise la patience en la reconnaissant du bout de la moustache tendue vers l’espace comme le pistil d’une fleur odorante.
La nuit morceau souple et soyeux de l’infini me regarde et me file un coup de patte si jamais je me penche plein de larmes vers son épaule. Son regard est celui de qui se nourrit de comètes et des miettes que laissent les étoiles derrière elles quand on croit qu’elles s’attrapent comme des souris.
Sur ta chaise, une cigale silencieuse se moque de moi. J’ai peur que ses sœurs tziganes s’asseyent en faisant grincer les pieds des chaises comme quelques vieux instruments de musique désaccordés.
Le soleil s’étale sous les acacias à la manière d’un fauve qui attend que la chaleur lui fasse un peu de place pour la chasse. L’orchestre caché dans les feuillages et qui serait prêt à faire chavirer l’été ne fera pas le poids si tu n’es plus là pour le guider.
Sur ta chaise l’insecte se délecte de mes craintes. J’agrippe aussi fort que je le peux quelques bourgeons gorgés de suc. Au creux de ma main, la poudre d’or ressemble à celle que l’on trouve sur les paupières quand le sommeil appareille son grand voilier pour le ciel.
Un fantôme se tient debout près de la table, ses mains épousent les mêmes teintes rosées que les tiennes. Je ne comprends pas pourquoi, il tient tellement à imiter ta voix.
La cigale assise à ta place a gommé les moments inutiles de la vie dans lesquels tu ne figures pas. Les mimosas grimpent dans le ciel par grappes odorantes, de petits fleurs jaunes et rieuses se prennent pour des étoiles. Ce sont elles qui attellent la Méditerranée bleue à la nue, au soleil.

Ce n’est pas un cheval qui se laisse conduire à l’aube
c’est la fraction la plus sombre de la nuit
qui
habillée de taffetas
écrit
¤
un fantôme
une brassée d’ombres
une encre dévorée par les chuchotis
des vagues qui menacent à tout instant
ce qu’on appelle l’âme
mettent en place les phrases
¤
chacune a ce regard de faon
cette proportion frêle de fleur aquatile
¤
qui donc se souvient du bruit que fait au loin
le train
qu’on t’empêche de prendre

Du ciel
la lueur
pleure
un lac
blanc

à sa surface
les feuilles
sont
les paupières
de l’arbre
il se regarde
fondre et trembler
dans l’eau
il se garde
du ciel
la lueur

un lac blanc
pleure
les feuilles
de l’arbre
à la surface
du ciel
sont
les paupières
Au sein de la nuit sans lune
sur le sentier froid
creusé par le poids de son corps
et de la maladie
au milieu de son lit
soudain comme une feuille de papier
supportant les rides de l’ultime poème
son cœur s’est déchiré.
•
À la lumière
à l’aurore
on prétendit
que la mort était survenue
sans le moindre remous.
•
Sur la plage pourtant
la mer semblait avoir perdu
la bataille qu’elle livrait
contre l’hiver.

Un arbre
se penche vers moi et me regarde
les branches servent de rivière à la
lumière
le tronc de livre ouvert sur l’écriture
·
un arbre
sans racine
·
seule la sève
décide du profil des feuilles
·
qu’il porte
comme un masque jusqu’à la cime
·
un arbre
sans répit
divulgue ses strates de poussières
se partageant un infini
qu’encerclent les ombres
d’un trait
·
telles les vagues
l’océan.
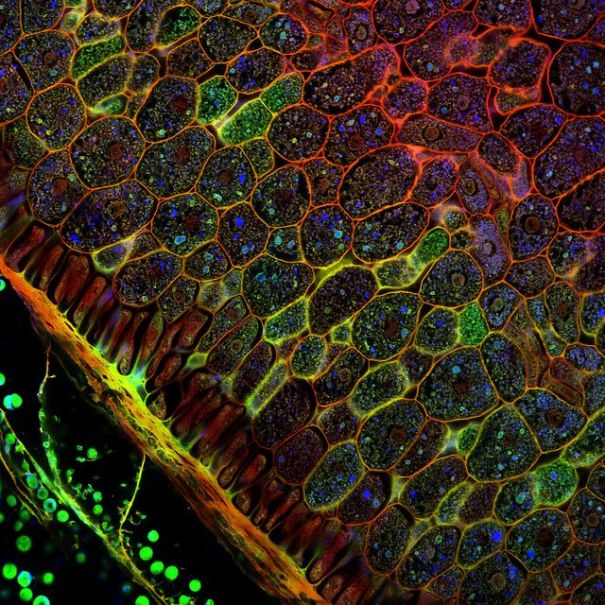
Aux sommets de la tige, l’intervalle d’une feuille orchestre sa répétition pétillante. Le soleil se plante partout où il trouve l’espace. Ses aiguilles voraces crient et creusent des rainures pour les ombres.
Les roseaux se froissent. Les feuilles, les tiges ont l’audace de former cette étoffe qui répond à la soif de l’ombre. Ici, le sol est presqu’aussi humide à midi qu’à l’aurore, qu’à la nuit. Les végétaux font de la haute voltige en donnant aux ombres le goût d’une forêt qui pleure l’automne en plein mois de juillet.
Les feuilles souples se diluent, s’épaississent, s’épuisent ou deviennent si tranchantes qu’en les cueillant on s’entaille la paume des mains. Je me souviens qu’enfant, ces bosquets humides livrés aux dents du soleil, dans leur résistance à vouloir à tout prix produire du frais pour mes pieds nus marchant sur les sentiers qu’ils dessinaient, m’effrayaient. Il faut dire que les roseaux avaient appris au vent à se servir de leurs corps pour construire des flûtes de pan et que les chants magiques s’emparaient de ma joie pour la rendre incompréhensiblement triste.
A travers des musiques dispersées par le vent, la voix des végétaux d’une une beauté lucide me révélait sa mesure. Elle n’était pas infinie comme je me le figurais mais précisément définie par un petit lambeau du temps qui bientôt s’évanouirait.